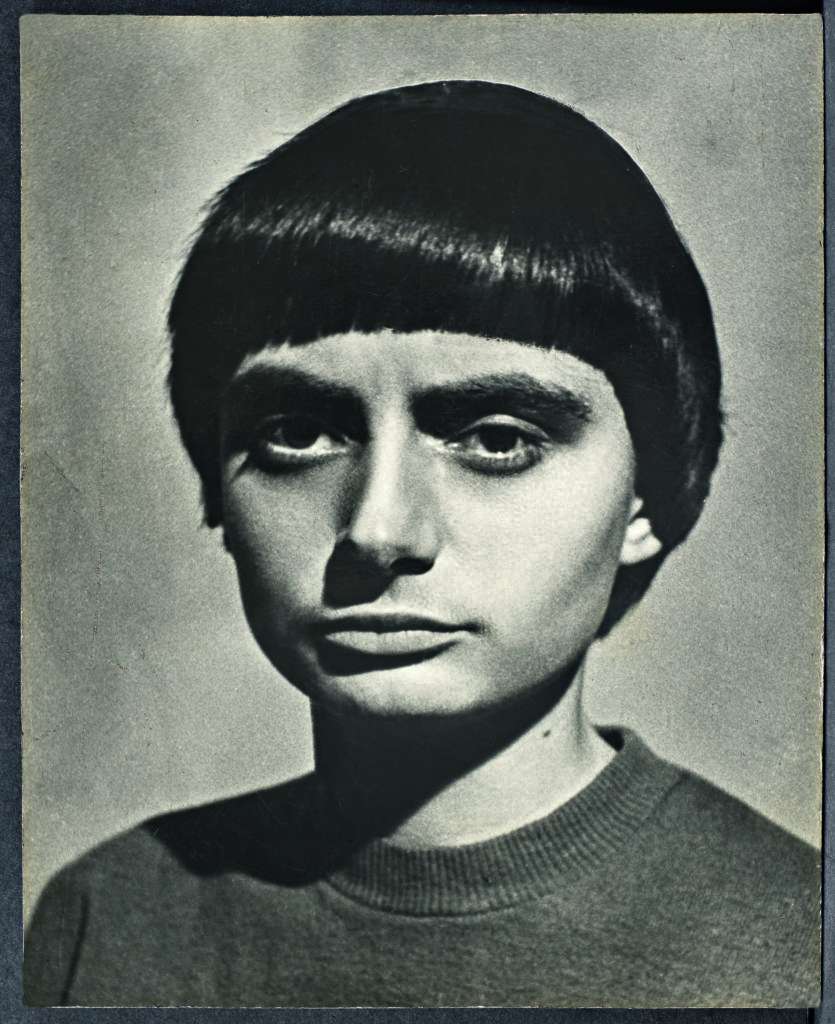
« Je la regarde, si raide, légèrement maquillée pour se rendre plus vieille, elle a 22 ans et ne veut pas séduire pour ce premier autoportrait. Elle aime la peinture de la Renaissance et, déjà, elle impose une vision originale d’elle-même, qui n’est pas basée sur la séduction. Son regard est droit : elle nous regarde comme elle va regarder sa vie, et quelle vie ! »
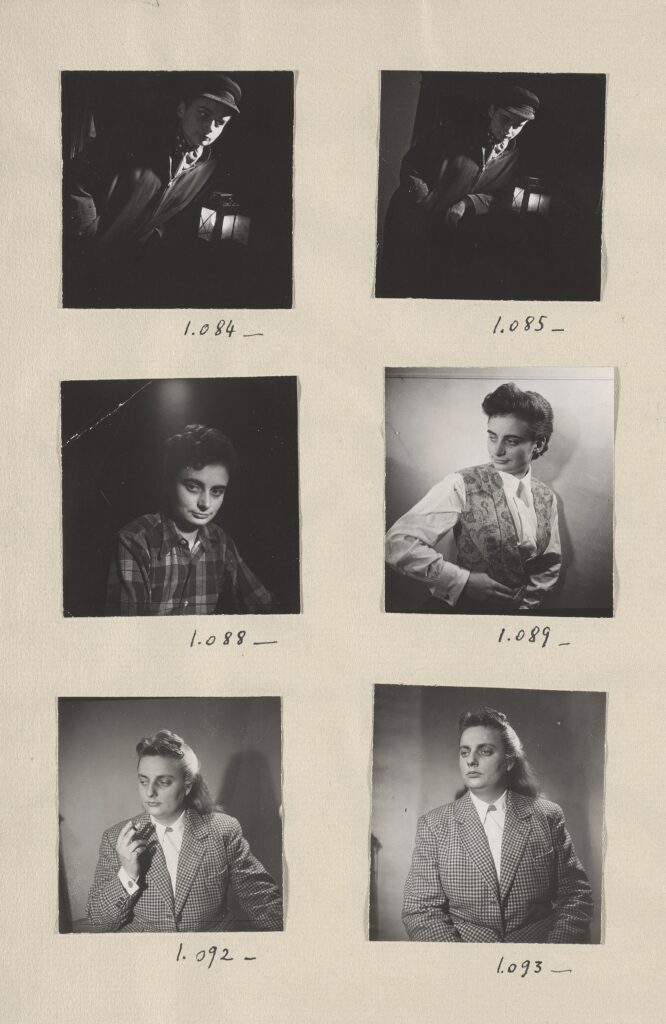
« Ces photographies d’Agnès et Linou (Valentine Schlegel) sont faites avec son Rolleiflex, vraisemblablement dans un appartement cité Malesherbes où elles étaient en colocation avec plusieurs jeunes femmes. Sa relation avec Linou est jolie [Varda a eu une grande histoire d’amour avec elle, ndlr]. Elles s’installent toutes les deux rue Daguerre en 1951, et Agnès va documenter son travail de céramiste et de sculptrice. Elles resteront amies toute leur vie. J’ai consacré à Valentine un petit livre, La Maison de Rosalie. »
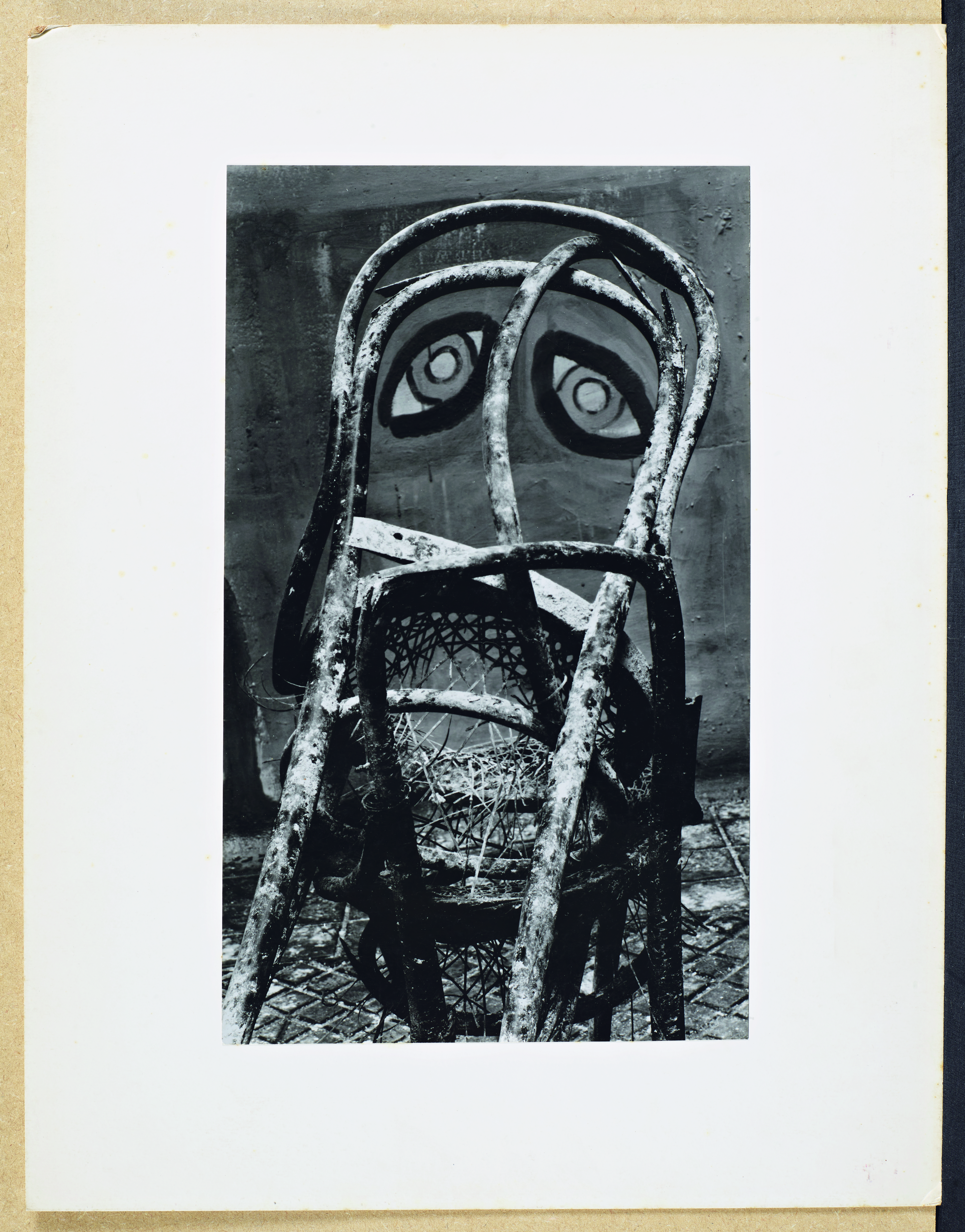
« Cette photographie fait partie d’une série, Drôles de gueule, inspirée par les surréalistes, dans laquelle Agnès transformait des objets du quotidien. Nous avons dressé un inventaire après le décès d’Agnès et on a répertorié plus de vingt-sept mille négatifs ! La photographie a fait partie de sa vie, même si, de son vivant, elle n’a pas été reconnue comme photographe. »

« Le jardin du Luxembourg, le jardin de mon enfance avec son manège, les poneys et le guignol que je n’aimais pas ! Les masques nous interpellent, comme si ces enfants étaient des créatures venues d’ailleurs. »

« Agnès et Claude Berri se sont connus jeunes, à la fin des années 1950. J’aime énormément ce portrait qui est une commande pour illustrer un thème dans la très belle revue Réalités : la jeunesse inspirée par la littérature. Claude, une personnalité complexe, acteur, metteur en scène, producteur et collectionneur d’art, a eu plusieurs vies. Alors qu’il produisait Tess [de Roman Polanski, 1979, ndlr], il venait souvent rue Daguerre évoquer le tournage et ses problèmes financiers… Je garde le souvenir d’un ami de ma famille, d’un producteur à l’ancienne, qui pouvait tout décider autour d’un repas. »
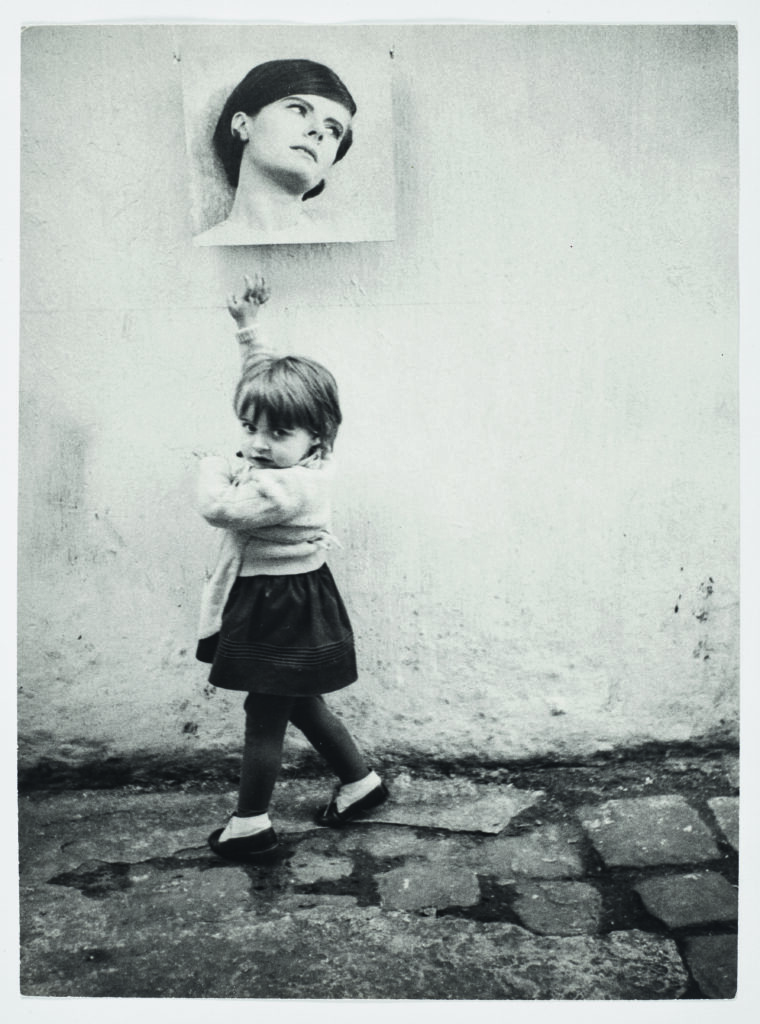
« Je ne me rappelle pas ce moment précis dans la cour de la rue Daguerre ! Mais je me souviens de l’ambiance de l’atelier, du studio photo et surtout du laboratoire avec sa lumière rouge au-dessus de la porte pour signaler si on pouvait y entrer. L’odeur des révélateurs, la table où l’on repique les photographies, toute cette ambiance, c’est “ma madeleine de Proust”. Delphine Seyrig, Agnès l’a connue dans les années 1950 avant qu’elle tourne avec Alain Resnais. Une amitié joyeuse, des femmes engagées dans le combat pour obtenir non seulement la parité des salaires, mais en premier le droit à la contraception et à l’avortement. Ensemble, nous sommes allées manifester. »
Le Paris d’Agnès Varda, de-ci, de-là, au musée Carnavalet – histoire de Paris, jusqu’au 24 août
● ● À LIRE AUSSI ● ● The End : on décrypte la fin du « Bonheur » d’Agnès Varda

