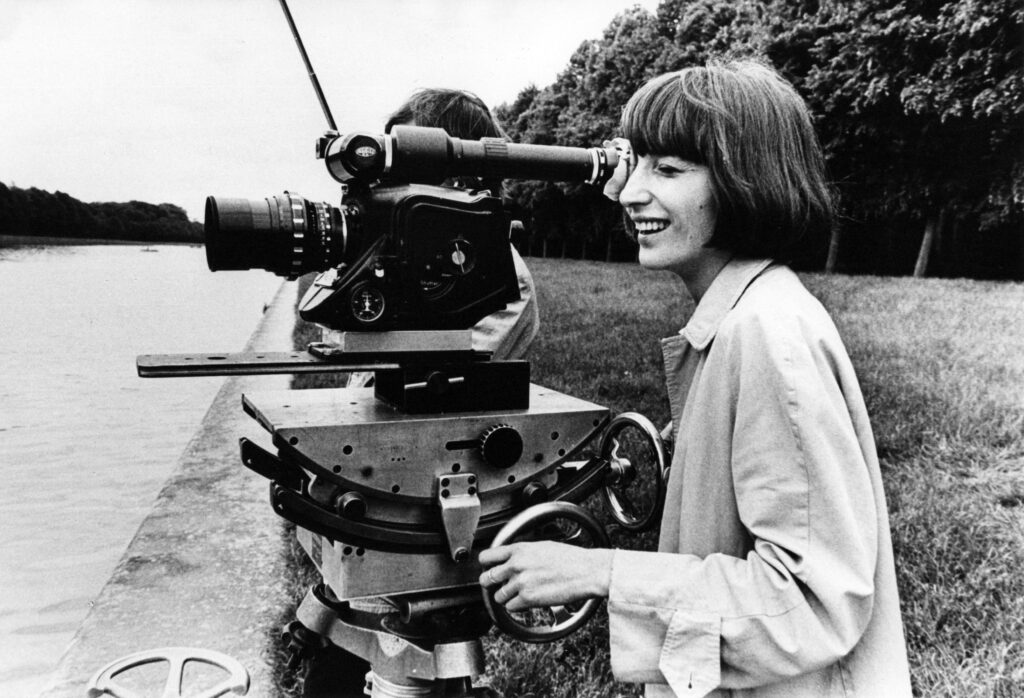Saint Omer était un film complexe et éprouvant. Est-ce qu’il continue de vous habiter ?
Non, plus vraiment. J’étais très contente de tourner ce nouveau film court, léger – enfin, ce n’est pas du tout un film léger dans ce qu’il traite, mais léger dans la manière de le tourner, instinctive, rapide. Il m’a fait passer à autre chose, m’a emmenée ailleurs, dans un rapport au cinéma plus sensuel, moins cérébral. Il m’a permis de digérer tout ce qui a été difficile à digérer après Saint Omer : ce que le film a déplacé en moi, ce qu’il m’a fait interroger, ce qu’il a généré aussi chez les gens, tout ça était très dense. Il y a eu un effet de sidération. J’ai eu l’impression de passer un an à courir après ma vie, de promotion en promotion, de projection en projection. Je ne sais pas combien de pays j’ai traversés dans le sillage de ce film. Retrouver mon centre, ça a pris du temps.
● ● À LIRE AUSSI ● ● Alice Diop : « Tout s’effondre au procès, en voyant cette femme d’une complexité absolument sidérante »
Vous nous aviez dit à l’époque : « Les films qui me réparent sont ceux que je fais ; je les fais dans une volonté de donner une forme à ma colère, à ma révolte. » De quelle colère est né ce nouveau film ?
Il n’est pas du tout né d’une colère. La colère, elle vous draine et c’est une trop grande partie de soi-même qu’on offre à « l’ennemi ». Je n’ai plus du tout envie d’être à cet endroit-là. C’est un film serein, d’une grande douceur, assez simple, et j’espère plus complexe qu’il n’y paraît derrière son apparente simplicité, car il n’en est pas moins radicalement politique.
Quelle est la première image qui vous est venue pour Fragments for Venus ?
Ce n’est pas tant une image qu’une sensation : moi, dans la grande galerie des sculptures du Met [Metropolitan Museum of Art, à New York, ndlr], avec ce contraste entre mon corps de femme noire et ces sculptures de marbre qui m’entourent et qui portent toute une histoire de l’art occidental.
La première partie du film est tournée dans les allées du Louvre. Pourquoi ce musée en particulier ?
Ce n’est pas le Louvre en tant que tel que je voulais filmer, mais l’idée du musée, de traverser l’histoire de la peinture occidentale. J’avais fait des repérages à la Galleria Borghese [à Rome, ndlr], puis je devais filmer au Met, qui m’a refusé l’accès, à mon avis, pour des raisons politiques.
C’est-à-dire ?
Dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, il y a eu une vraie prise de conscience, dans les grandes institutions culturelles américaines, et au Met en particulier, de la nécessité de donner une place aux artistes contemporains afro-américains. C’était donc pour moi une évidence de demander l’autorisation de filmer dans ce musée autour de ces questions de représentation. Sauf que ma demande est arrivée une semaine après l’investiture de Donald Trump. Et j’ai pu voir, dans le refus radical du Met, à quel point toutes ces questions pouvaient être une forme de diversity washing, un certain opportunisme politique qui pouvait conduire à réfléchir ou à ne plus réfléchir à ces interrogations. Toutes les portes peuvent se refermer sans qu’on se rappelle qu’elles ont été ouvertes un jour. J’ai l’impression que c’est ce qui se passe aujourd’hui aux États-Unis. J’ai vu dans ce refus une sorte de capitulation morale et politique. D’où la nécessité de ce film, justement, qui n’est pas fait dans la colère, mais dans la sérénité. La sérénité d’affirmer que ce n’est pas un effet de mode, qu’on porte les questions les plus brûlantes de notre époque – la manière dont on se pense ensemble, dont on vit ensemble.
● ● À LIRE AUSSI ● ● Alice Diop en cinq docus
Comment avez-vous découvert le texte de la poétesse afro-américaine Robin Coste Lewis, Voyage of the Sable Venus, dont vous lisez un extrait en voix off dans le film ?
Robin Coste Lewis est très peu connue ici, mais son recueil Voyage of the Sable Venus, qui a obtenu le National Book Award en poésie en 2015, vient d’être traduit et va être édité en France [Odyssée de la Vénus Noire, à paraître en novembre aux éditions Gallimard, ndlr]. Dans le cadre d’une résidence à la Villa Albertine à New York, j’ai mené une recherche sur la manière dont des poétesses afro-américaines, comme Lucille Clifton, Gwendolyn Brooks, June Jordan, ont formulé dans leurs œuvres l’impact de la violence raciste sur leur manière de se vivre et d’être en relation avec les autres – donc une perception vue d’un endroit intime. Ces femmes étaient souvent théoriciennes dans le champ des études postcoloniales ou de la théorie critique de la race, et parvenaient à trouver une formulation artistique à leurs recherches. Ça a été très important pour moi, car c’est exactement ce qui m’intéresse en tant que cinéaste. Dans le cadre de mon enquête, j’ai découvert le recueil de Robin Coste Lewis dans lequel le poème homonyme est le fruit d’une recherche colossale : elle a répertorié tous les titres et les cartels qui mentionnent la présence du corps d’une femme noire dans une œuvre, depuis l’Antiquité.
Le poème est une énumération de ces titres, il fait une cinquantaine de pages, et il est extrêmement puissant, sidérant même, parce qu’il permet de révéler ce qui est compliqué à percevoir : la façon dont ces corps sont confinés à la marge, fétichisés, objectivés, et tout cet inconscient visuel sur lequel repose l’histoire de l’art occidental. Le texte crée des images d’une puissance folle. Dans l’épilogue à la fin du recueil, Robin Coste Lewis raconte sa recherche dans un texte, et il y a notamment une partie onirique dans laquelle elle s’imagine être à la tête d’un bateau gouverné par une Vénus noire, qui traverse les musées du monde pendant la nuit pour y recueillir les corps démembrés de ces femmes qui peuplent la marge des tableaux depuis l’Antiquité. Cette image d’un bateau rempli de fragments de corps de femmes noires, qui recomposent une femme entière, exprime tellement de choses sur nous, sur moi, sur notre origine. Et ça dit aussi la puissance de la réparation que peut apporter un poème, un film. C’est un texte qui m’a nourrie, qui m’a soignée, qui m’a même guérie. D’ailleurs, je vais performer cet épilogue à la MC93 en novembre, dans le cadre du festival d’Automne.
C’est dans le cadre de cette résidence à la Villa Albertine que vous avez eu envie de filmer la seconde partie du film à Brooklyn ?
Je faisais déjà des allers-retours à New York pour la promotion de mes films, mais la résidence m’a permis d’y vivre pendant trois mois, surtout à Brooklyn, dans des quartiers historiquement noirs autour de Fort Greene et de Bed-Stuy. Dans ce quartier précis de New York, il n’y a pas une journée où tu ne rencontres pas une femme noire qui te lance : « Mais ma sœur, qu’est-ce que tu es belle ! » Il y a une espèce d’autocélébration qui est extrêmement douce, et c’est autant intime que politique de mesurer les effets que ça peut produire sur soi-même. L’expérience d’être en présence d’autres corps de femmes noires, d’évaluer l’impact de cette reconnaissance mutuelle, m’a également permis de souligner le non-dit qui entoure la question d’être une femme noire en France, et la difficulté d’interroger cette invisibilisation et ses effets. Toute cette partie du film à Brooklyn est une retranscription de cette sensation.
La fin du film rend hommage à plusieurs artistes contemporaines. Pouvez-vous nous parler d’elles ?
La première qui me vient à l’esprit est Simone Leigh. Un jour, je me suis vue en photo en couverture d’un journal, et j’ai ressenti un inconfort devant mon image. Mon attachée de presse m’a dit : « Mais non ! Tu me fais penser à une sculpture de Simone Leigh. » Je ne la connaissais pas. Quelques mois plus tard, j’ai visité une rétrospective consacrée à son travail à l’ICA de Boston, et devant ses sculptures monumentales, je me suis mise à pleurer. L’immensité, la puissance de ces visages statuaires de femmes noires que je n’avais jamais vus dans un musée m’ont bouleversée. Puis je l’ai rencontrée. Simone avait beaucoup aimé Saint Omer. Nous sommes devenues amies et elle m’a accueillie chez elle quand je tournais à Bed-Stuy. J’ai eu l’impression d’être entourée, protégée par la puissance et la bienveillance de cette femme.
Je peux aussi parler de Jennifer Packer, dont la peinture m’a sidérée. Et de la photographe Zanele Muholi. La photo d’elle que je mets dans le film est hyper symbolique d’un moment de ma vie où j’ai décidé de délaisser la colère pour me tourner radicalement vers la sérénité. Et puis, il y a le magnifique autoportrait de Nona Faustine, qui est en couverture de son livre White Shoes [édité par MACK Books en 2021, le livre rassemble une collection d’autoportraits qui ont aussi fait l’objet d’une exposition au Brooklyn Museum, à New York, en 2024, ndlr]. J’ai appris sa mort avec beaucoup de peine il y a quelques mois, pendant que je tournais. Le film lui est dédié. Le travail de ces femmes me donne de la force, parce qu’au-delà du discours intime et politique qu’elles portent elles sont parmi les artistes contemporaines les plus intéressantes formellement aujourd’hui.
Le Voyage de la Vénus noire, à la MC93 (Bobigny), du 19 au 30 novembre