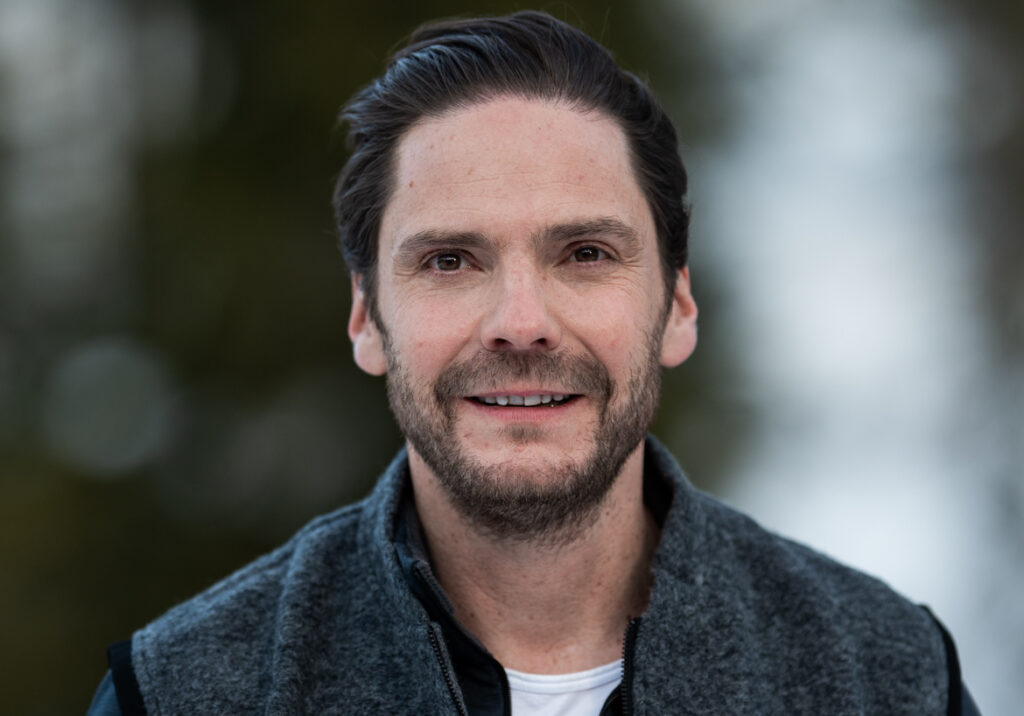
Good Bye, Lenin ! (2003) est projeté aux Arcs Film Festival. Quels sentiments vous inspire ce film, qui parle avec force du choc de la réunification allemande et a aussi lancé votre carrière ?
On a fêté le vingtième anniversaire du film il y a deux ans. C’est intéressant de constater qu’il reste pertinent et touche encore les gens. Politiquement, c’est frappant de regarder quelque chose qui renvoie à un moment si important, et c’est aussi émouvant d’entendre mon personnage [celui d’Alex Kerner, fils dévoué, qui recrée une RDA factice pour protéger sa mère après la chute du Mur de Berlin, ndlr], qui a une certaine vision de l’avenir de son pays. Malheureusement, la vision et les rêves que ce jeune homme avait ne se sont pas réalisés… Donc ça donne un sentiment doux-amer. Et ça provoque une certaine émotion chez moi parce que le réalisateur [Wolfgang Becker, ndlr], qui était mon ami, est décédé il y a un an [en décembre 2024, ndlr]. Il était comme un second père pour moi. J’étais heureux de faire son dernier film [dont le titre allemand est Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, et qui est sans date de sortie en France. Le cinéaste l’a tourné juste avant sa mort, ndlr], qui vient d’être projeté en Allemagne. Ma trajectoire n’aurait pas été la même sans lui.

Les années suivantes, vous avez multiplié les films engagés avec Salvador, The Edukators, L’Enquête, À l’Ouest, rien de nouveau… Quelle place prend cette notion d’engagement dans vos choix ?
Je continue d’être attiré par ce type de films parce qu’au fond, je pense que ça a à voir avec d’où l’on vient, notre éduction, l’environnement dans lequel on grandit, la conscience sociale et politique qu’on développe. Je suis heureux que mes parents m’aient transmis un intérêt, une curiosité pour ces sujets. Je veux utiliser le cinéma comme un moyen de raconter des histoires qui valent la peine d’être racontées et qui, on l’espère, inspirent, ou du moins font réfléchir, ressentir quelque chose. Si cela ne touche que quelques personnes, c’est déjà beaucoup.

Vous avez grandi avec un double héritage culturel : espagnol (du côté de votre mère, ancienne professeure) et allemand (du côté de votre père, qui était réalisateur pour la télévision allemande). Comment cette dualité se manifeste dans votre vision artistique ?
Il y a aussi du français dans ce mix, parce que deux de mes oncles allemands étaient mariés à des Françaises, l’une de Toulouse, l’une de Paris. On a grandi tous ensemble en Allemagne, mes cousins et moi, et on parlait français, espagnol, catalan… ça a forcément élargi notre horizon à tous. Quand j’allais dormir chez mes cousins, on entendait de la musique française, ma tante cuisinait français, on regardait des films français, on écoutait la radio française… C’était toujours très joyeux. Puis je rentrais chez moi, et là c’était moitié Espagne, moitié Allemagne – ma mère écoutait de la musique espagnole, regardait des films espagnols. C’est comme ça que tout a commencé. Donc évidemment, mon rêve, quand j’ai commencé, c’était aussi de franchir les frontières, de ne pas être limité à l’Allemagne.
« Parfois, je suis inquiet de voir que certains pays se retrouvent réduits à une seule chose, un cliché. »
Vous avez souvent incarné des personnages allemands liés à une histoire lourde. Est-ce une responsabilité que vous ressentez, un choix conscient ?
Oui et non. J’ai toujours été intéressé par l’Histoire, parce que je pense qu’elle nous aide à comprendre qui nous sommes aujourd’hui. Regarder en arrière est toujours intéressant, surtout quand on pense à tout ce qui s’est passé au XXe siècle.
Mais parfois, je suis aussi un peu inquiet de voir que certains pays – y compris le mien – se retrouvent réduits à une seule chose, une sorte de marque, de cliché. Si je sens qu’il est intéressant de revenir sur un chapitre précis du siècle dernier — que ce soit le début ou la fin du Troisième Reich, par exemple – et que cela résonne pour moi en tant qu’Allemand, alors je suis heureux de le faire. Mais on m’a proposé tellement de rôles où il s’agissait juste d’enfiler un uniforme… Et je me dis qu’il y a bien plus que ça. L’histoire allemande est fascinante quand on remonte un peu plus loin. Il y a tellement d’autres histoires à raconter. Mais tout est souvent écrasé par ces événements historiques dramatiques du XXe siècle qui reviennent sans cesse. Cela dit, c’est pareil pour mes amis sud-américains, à qui on propose toujours des rôles de trafiquants de drogue, ou pour mes amis turcs et arabes, qui doivent toujours jouer des terroristes… On n’est pas les seuls.
« Je n’ai pas peur de la pop culture au cinéma. »

Vous êtes entré dans l’écurie Marvel avec notamment Captain America : Civil War (2016), puis Falcon et le Soldat de l’hiver (2021), où vous incarnez un personnage antagoniste, le Baron Zemo. Qu’est-ce que ces expériences dans de grosses productions hollywoodiennes vous ont apporté que le cinéma européen ne vous donnait pas ?
J’ai toujours aimé ne pas avoir de préjugés vis-à-vis du cinéma, de ses genres. Je trouve que c’est une aventure d’aller explorer des territoires comme celui-là. Il y a aussi une petite provocation là-dedans, face aux gens qui disent : « Mais comment peux-tu faire ça ? » Ce qui me donne encore plus envie de le faire ! Comme quand je suis dans ma voiture et que j’écoute mes guilty pleasures — dont je suis d’ailleurs assez fier, comme la pop –, je n’ai pas peur de la pop culture au cinéma non plus.
Et quand j’ai l’impression d’avoir fait le tour, je suis heureux de passer à autre chose. Je ne deviens pas obsédé par un seul type de cinéma. Quand l’offre de Marvel est arrivée, j’étais simplement curieux. J’avais envie de voir comment ça se passerait. Et on apprend énormément. C’est un tout autre fonctionnement. Mais je ne pense pas que ce type de cinéma soit responsable du déclin d’un autre. Au contraire, je crois que certaines formules ne fonctionnent plus. Et je suis convaincu que les gens vont revenir vers autre chose. L’Europe est un territoire très fort pour ça, parce que les histoires qui y sont racontées restent humaines, faites par des êtres humains, originales.
« Je pense qu’un jour on recommandera le cinéma pour des raisons de santé mentale. »
Quel regard portez-vous sur l’intelligence artificielle, dont l’influence dans le quotidien mais aussi dans la mise en forme de nos récits s’étend de jour en jour ?
Je pense que l’engouement pour l’artificialité, l’intelligence artificielle finira par lasser les gens. Ils retourneront au cinéma pour voir un cinéma véritablement humain. On le sent déjà, ce désir. Pour moi, le cinéma est la seule vraie échappatoire. Si vous êtes une personne civilisée, vous ne sortez pas votre téléphone dans une salle. Vous n’êtes pas distrait. À la maison, quand on regarde un film, qu’on lit un livre ou qu’on écoute de la musique, les distractions sont constantes – je me l’applique aussi à moi-même. Il m’est devenu plus difficile qu’il y a vingt ans de lire longtemps sans interruption. Le cinéma est un temple sacré. C’est sain pour l’esprit. Je pense qu’un jour on recommandera le cinéma pour des raisons de santé mentale. Il vous force à rester dans une autre réalité, à être hypnotisé, à méditer presque. À se concentrer sur une seule histoire pendant deux heures. Il y a quelque chose de profondément sain là-dedans.
« J’ai cette envie un peu pathétique de plaire à tout le monde. »
En 2021, vous êtes passé derrière la caméra avec Next Door, qui parle beaucoup de célébrité, de la culpabilité sociale, du malaise du privilège. Est-ce que ce film, très méta, est né d’un inconfort personnel lié à votre statut d’acteur reconnu, votre image publique ?
C’est exactement ça. Je voulais me moquer de moi-même. J’ai vécu avec ce sentiment d’incohérence pendant longtemps, et je le vis encore. Je fais partie du processus de gentrification à Berlin, j’étais l’une de ces personnes venues de l’Ouest qui en « envahi » l’Est, qui avaient l’argent pour le faire, qui ont changé les quartiers, ont fait augmenter les prix… Et en même temps, j’ai toujours ce besoin d’être aimé, apprécié – même par un journaliste. J’ai cette envie un peu pathétique de plaire à tout le monde. Dans le film, j’exagère évidemment les choses, je ne suis pas aussi idiot que mon personnage et mon appartement n’est pas aussi luxueux. C’est une version amplifiée de ce que j’ai réellement vécu.

Vous avez une passion pour la cuisine. Vous avez ouvert le restaurant à tapas Bar Raval à Berlin, et publié avec Atilano Gonzalez le livre ¡Tapas!, non traduit en France. D’où ça vient ?
Ma passion pour la cuisine vient beaucoup de ma famille. De ma mère, et surtout ma tante française Françoise, celle de Toulouse, avec son cassoulet. Enfant, manger ça en Allemagne me semblait étrange, mais j’ai toujours adoré. Il y avait tellement d’amour, de dévouement, de passion. J’admire aussi des figures comme Lino Ventura. J’ai vu un documentaire où on le voyait cuisiner pour tous ces grands acteurs… Ou Fellini : lors d’une exposition que j’ai vue sur ses pauses déjeuner, je l’ai envié parce que non seulement il faisait chef-d’œuvre sur chef-d’œuvre, mais en plus, ses déjeuners étaient un plaisir. Voir ces images de Marcello Mastroianni qui mange des pâtes, avec Fellini qui plaisante… Je me suis dit que j’aimerais juste partager un seul déjeuner avec eux. Quand je tourne, la nourriture est essentielle. Sur mon propre film, pendant la pandémie, tout était difficile et le budget réduit. J’ai dit à mon producteur : la chose la plus importante, c’est une nourriture bonne, saine, généreuse pour tout le monde. Économiser là-dessus est une énorme erreur. J’ai tourné sur tellement de films avec un catering [ravitaillement, restauration sur les plateaux, ndlr] horrible… La première chose que je fais, c’est repérer les meilleurs endroits et organiser autre chose.
● ● À LIRE AUSSI ● ● Gastronomie et cinéma : quand les plats font leur politique
Le tournage d’À vif ! de John Wells (2015), sur une rockstar de la cuisine incarnée par Bradley Cooper, n’a pas dû vous déplaire…
On avait de vrais chefs, une vraie brigade, une cuisine Michelin. Tout devait être réel, on ne pouvait pas tricher. Pendant les pauses déjeuner, tout le monde partait manger ailleurs. Moi, je demandais aux chefs : « Vous mangez quoi ? » « Ce qu’on a cuisiné, sinon c’est jeté. » Pendant deux ou trois semaines, j’ai mangé en cachette avec eux. La meilleure nourriture… Un jour, Bradley Cooper est descendu et m’a dit : « Ah, c’est donc là que t’étais. T’es pas idiot. »

Sur quoi vous travaillez maintenant ?
Je vais réaliser un film sur le grand joueur de tennis Gottfried von Cramm. Je suis un immense fan de tennis. J’ai toujours voulu faire quelque chose autour de ce sport. Et Gottfried von Cramm [qui sera interprété par Felix Kammerer, ndlr] est une figure fascinante. Il était notre meilleur joueur, mais il menait une double vie. Il était homosexuel, prétendait ne pas l’être, vivait sous pression. C’est l’histoire d’une vie queer très libérale à Berlin, encore plus libre que le Berlin que j’ai connu [Daniel Brühl vit désormais à Majorque, en Espagne, ndlr]. Les années 1920 et le début des années 1930 étaient incroyables. Je veux aussi parler du poison politique, du populisme, et en faire quelque chose de très actuel — ce qui se passe aujourd’hui avec l’AfD [parti d’extrême-droite allemand de plus en plus influent, ndlr], avec l’extrême droite en France, en Espagne… Je ne veux pas faire un film sur le passé, mais sur notre présent. Ce projet vient de la société de production Amusement Park Film, dont on est partenaires avec mon ami Edward Berger, qui a réalisé À l’Ouest, rien de nouveau [2022, ndlr].
Pourquoi avoir activement pris part à cette société de production, justement ?
J’ai commencé à produire il y a dix ans parce que je ne voulais pas devenir un acteur vieux et frustré, attendant que le téléphone sonne. Je voulais être proactif : écrire, développer, produire, réaliser. C’est mon deuxième film. Et je me sens un peu comme ce matin à la tyrolienne – je suis un très mauvais skieur. Je n’ai jamais appris enfant. C’est pareil avec mon film : je ne sais pas encore exactement comment je vais y arriver, mais c’est une sensation merveilleuse. On se jette dedans, étape par étape. Travailler sur le scénario, trouver les acteurs, les lieux, être le capitaine du navire… c’est exaltant.

