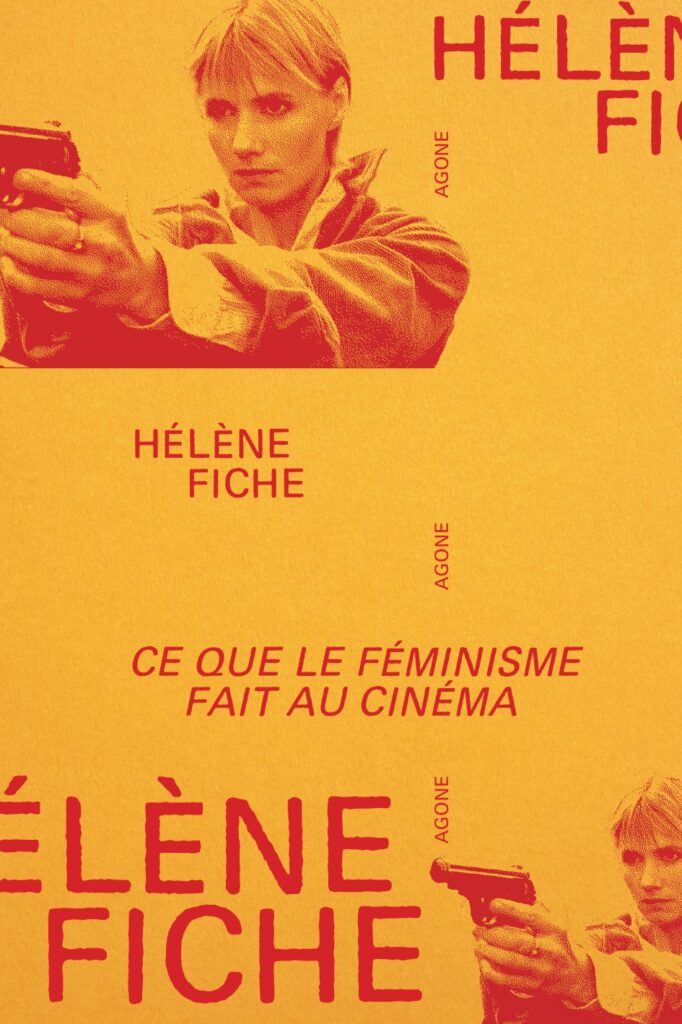Dans son premier ouvrage Ce que le féminisme fait au cinéma, l’historienne du genre Hélène Fiche dresse un portrait méticuleux du cinéma des années 1970, en étudiant un corpus de 362 films, tous réalisés entre 1969 et 1982 et sélectionnés en fonction de leur succès en salles (700 000 entrées et plus). Femmes fatales, adolescentes survoltées, hommes en crise ou patriarches déclassés… Elle précise les contours des personnages qui peuplent le cinéma de cette époque, et où gronde, derrière le vernis progressiste, une riposte violente. Au fil des pages, elle livre des clés d’analyses puissantes pour décortiquer ces représentations genrées qui infusent encore le cinéma du XXIème siècle. On a rencontré l’autrice pour en discuter.
Pourquoi avoir choisi la décennie 1970 en particulier ?
Du point de vue des représentations genrées et des études cinématographiques, c’est une décennie qui n’avait encore jamais été étudiée, avec des ruptures intéressantes. En 1970, la création du Mouvement de libération des femmes [la première manifestation de ce mouvement visant à obtenir l’égalité de tous les droits, moraux, sexuels, juridiques, économiques entre les hommes et les femmes a lieu le 26 août 1970, ndlr] induit une massification du mouvement féministe, qui trouve ses racines dans certaines luttes de la fin des années 1960, comme la loi Neuwirth [adoptée en 1967, ndlr] qui permet l’accès à la contraception orale. Les années 1970 intensifient la pression sur les décideurs politiques : les luttes féministes deviennent un mouvement de masse. C’est pour ça que d’un point de vue historique, on parle de la deuxième vague du féminisme.
Qu’est-ce qui a suivi cette décennie de bascule ?
Dès le début des années 1980, on assiste à un backlash politique [terme popularisé par Susan Faludi en 1993 avec la parution de son livre Backlash, La guerre froide contre les femmes dans lequel elle analyse la réaction des conservateurs américains contre les droits des femmes dans les années 1980, ndlr]. Il y a eu la création d’un ministère des Droits des femmes [un secrétariat d’État à la Condition féminine, créé en France en 1974 par Valéry Giscard d’Estaing, ndlr], puis peu à peu cette idée que l’égalité dans le droit a été obtenue s’installe [en 1972, le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est inscrit dans la loi. En 1975, trois lois entrent en vigueur : la loi du 17 janvier 1975 dite loi Veil qui autorise l’avortement, la loi du 11 juillet 1975, qui autorise le divorce par consentement mutuel et la loi Haby du 11 juillet 1975, instaurant l’éducation mixte, ndlr]. Les militantes commencent à se diviser et certaines vont raccrocher, estimant avoir obtenu ce qu’elles voulaient. C’est là qu’arrive ce retour de bâton, que les historiens situent dans les années 1981-1982. Au cinéma, on découvre qu’il est présent dès 1974.
Dans votre ouvrage, vous démontrez qu’il y a une différence de traitement à l’écran des thématiques féministes, que le cinéma « populaire » s’avère plus progressiste que le cinéma d’auteur. Comment expliquer cela ?
Le cinéma populaire, que j’appelle « films à succès » dans le livre, peut se distinguer d’une approche plus auteuriste, où le cinéaste serait omniprésent sur tous les aspects de la création du film – ce qui est parfois moins vrai pour un film de commande, demandé par un producteur. L’opposition des deux n’est pas toujours évidente et elle est parfois même problématique parce qu’elle est utilisée pour hiérarchiser un cinéma par rapport à l’autre. Mais dans les années 1970, c’est le cinéma dit « populaire » ou « commercial » qui s’empare le plus des thématiques portées par le mouvement féministe. À l’inverse, le cinéma d’auteur de cette époque, qui dans la lignée de la Nouvelle Vague estime être le seul capable d’échapper aux logiques commerciales, reste un cinéma d’hommes, avec un point de vue masculin. Il se révèle être bien plus réactionnaire sur la question du genre. Le cinéma d’auteur a une vraie difficulté à se décentrer de ce point de vue à la première personne, alors que l’opportunisme économique va forcer certains cinéastes et producteurs à se décentrer de ce point de vue, pour viser un plus large public [parmi les exemples cités dans Ce que le féminisme fait au cinéma, on retrouve Docteur Françoise Gailland de Jean-Louis Bertuccelli (1976), Tendre poulet de Philippe de Broca (1978), ou encore Vas-y maman de Nicole de Buron (1978), trois films ayant pour tête d’affiche l’actrice Annie Girardot, ndlr]

Votre corpus contient 2% de films réalisés par des femmes, qui pour la plupart refusent de qualifier leurs films de « féministes » et rejettent l’étiquette de « films de femmes » …
C’est facile de comprendre pourquoi cette terminologie leur hérisse le poil. Sur la période, 90% du cinéma est fait par des hommes et personne n’appelle ça des « films d’hommes ». De plus, les critiques ne cessent de les renvoyer à leur genre et ce, de manière extrêmement réductrice. Pourtant, dans les faits, qu’elles le veuillent ou non, leurs films sont imprégnés des revendications féministes, porteurs d’un regard féminin et proposent des représentations alternatives aux représentations dominantes, et masculines. Les seules à se revendiquer ouvertement féministes sont Nelly Kaplan, qui le fait avec beaucoup de légèreté avec La Fiancée du pirate [sorti en 1969, le film raconte l’histoire de Marie, une marginale qui décide de se venger des habitants du village qui la méprisent, ndlr] en précisant que c’est un film subversif, et Yannick Bellon [réalisatrice de La Femme de Jean en 1974 et L’Amour violé en 1978, ndlr], qui elle, est militante et le revendique.
Un chapitre entier du livre est consacré à Annie Girardot, une actrice très populaire à l’époque, incarnant souvent des « femmes agissantes », c’est-à-dire des personnages impulsant l’action dans le récit, mais qui aujourd’hui est moins connue que ses homologues masculins (Alain Delon, Jean-Paul Belmondo…) et féminins (Romy Schneider, Simone Signoret…). Pourquoi avoir voulu la réhabiliter ?
Le contraste entre la popularité qui a été la sienne et l’oubli dont elle a fait l’objet m’a frappée. Elle tournait à un rythme effréné, pratiquement tous ses films ont dépassé les 700 000 entrées. Des films pouvaient se faire uniquement sur son nom, elle avait des cachets équivalents, voire supérieurs à ceux d’Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Mais elle incarnait une féminité moins rassurante et acceptable que celle de Romy Schneider par exemple, qui elle était dans une vision très rassurante de la féminité. Elle incarnait des figures de femmes souvent tragiques, très dépendantes du regard masculin et toujours insérées dans des relations avec des hommes. Annie Girardot, c’est tout l’inverse. Elle jouait des personnages très indépendants, qui souvent sont châtiés pour leur indépendance. Cette féminité qu’elle a représentée a été possible car les luttes féministes du début des années 1970 ont ouvert une brèche, qui s’est refermée avec le backlash des années 1980. C’est comme ça qu’est venu l’oubli.
● ● À LIRE AUSSI ● ● PORTFOLIO · Romy Schneider en lumière
Dans les films de votre corpus, la représentation des féministes est souvent négative. Comment cela a-t-il influencé les décennies suivantes ?
Il y a eu quelques exceptions, comme Juliette et Juliette qui traite ce sujet au sérieux [réalisé par Remo Forlani en 1974, ce film met en scène Annie Girardot et Marlène Jobert dans le rôle de deux féministes de deux générations différentes, décidant de créer leur magazine, « Femmes en Colère », ndlr]. Mais la plupart du temps, les féministes sont représentées comme des femmes agressives, abjectes et caricaturées comme dans Calmos de Bertrand Blier [sorti en 1976, le film suit l’histoire de deux hommes s’installant dans un village paisible pour fuir les femmes, ndlr]. Dans la lignée de ce qu’a pu faire Blier, on retrouve dans les années 1980 beaucoup de personnages assez grossiers. Mais une des grandes victoires de l’antiféminisme de cette période est d’avoir associé le terme « féminisme » à un imaginaire de l’hystérie, de la dureté, de l’agressivité, à une attitude extrême. Ce qui entraîne chez les gens une autocorrection, où on n’ose pas se proclamer féministe.

Depuis le début du mouvement MeToo, certains films des années 1970 sont pointés du doigt pour leurs représentations problématiques. Comment appréhender ces films désormais ?
Au cours de la période, un certain cinéma érige la provocation et le politiquement incorrect comme mot d’ordre. Les revendications très légitimes des féministes, comme la libération sexuelle, sont parfois utilisées comme prétexte pour légitimer des humiliations des personnages féminins à l’écran, comme ça a été le cas dans Les Valseuses, qui a été un véritable triomphe [le film a fait plus de 5,7 millions d’entrées en salle lors de sa sortie, ndlr]. Dans cet ouvrage, j’établis, avec des preuves que ces films sont profondément antiféministes, mais c’est intéressant de les regarder comme des témoignages historiques d’une époque, et de les regarder aussi pour s’en offusquer. Il faut les décortiquer, les épingler, les déconstruire, voir comment l’antiféminisme se cache là où on ne l’attend pas. J’espère que ce livre donne des outils pour faire face à ces représentations qui reviennent. Nous sommes en post troisième vague du féminisme [l’Américaine Rebecca Walker est la première à parler d’une troisième vague en 1992, qui est notamment caractérisée par une réflexion sur l’intersectionnalité, ndlr] et tout cela est cyclique. L’antiféminisme de cette époque et certains de ses leitmotivs reviennent aujourd’hui. Décoder le cinéma des années 1970, c’est être capable de décoder le cinéma de 2025.
Quels exemples avez-vous en tête ?
D’abord, la figure de l’homme en crise, qui est un des thèmes de prédilection des masculinistes aujourd’hui. La génération incel [célibataire involontaire en français, ndlr], qu’on voit fleurir sur les réseaux sociaux, reprend cette idée que le féminisme est allé trop loin et qu’aujourd’hui les hommes sont victimes d’une dictature des femmes. Ils estiment qu’il n’y a pas eu une égalisation du pouvoir, mais un renversement du pouvoir. Ce qu’aucun indicateur ni politique, ni économique, ni culturel ne vient confirmer : c’est un vécu mais ce n’est absolument pas factuel. Au cinéma, dans les années 1970, les personnages d’hommes en crise, comme ceux qu’incarne Patrick Dewaere dans Coup de tête [réalisé par Jean-Jacques Annaud en 1979, ndlr] ou Série noire [réalisé par Alain Corneau en 1979, ndlr] sont des personnages qui vont mal, et qui s’inscrivent dans un contexte politique. À cette époque, beaucoup d’émissions de débat titrent : « Comment vont les hommes ? » ou « Où sont les hommes ? », ce qui est massivement repris par les antiféministes aujourd’hui. Puis, il y a aussi la figure que j’appelle dans le livre « la triste image de la femme seule », qui véhicule l’idée que pour avoir l’égalité, les femmes ont dû renoncer au bonheur. Il n’y aurait alors que deux alternatives pour les femmes : le couple et la famille patriarcale ou mourir seule dévorée par ses chats. C’est dans la lignée de la tendance de la « trad wife » [« épouse traditionnelle » en français, ndlr] qui gagne en ampleur aujourd’hui sur les réseaux sociaux.
Parmi les films de votre corpus, une figure masculine plus douce se distingue, celle du « gentil loser », un homme perçu comme peu viril qui séduit les femmes par sa douceur et son inoffensivité, souvent incarné par Pierre Richard. Aujourd’hui, des acteurs présentant une masculinité plus douce comme Paul Mescal ou Timothée Chalamet, gagnent à nouveau en popularité. Comment analyser ça ?
Dans un premier temps, cette figure du « gentil loser » revient en force dès le début des années 2000. Je pense à Gad Elmaleh qui séduit Audrey Tautou dans Hors de prix [dans ce film réalisé par Pierre Salvadori en 2006, le comédien français incarne un serveur timide qui se fait passer pour un milliardaire pour la séduire, ndlr], Dany Boon avec Diane Kruger dans Un plan parfait [réalisé en 2012 par Pascal Chaumeil, le film suit l’histoire d’une femme qui, pour contrer une malédiction familiale, épouse un homme qu’elle vient de rencontrer, ndlr]… On est en plein revival de Pierre Richard qui séduit Mimi Couturier dans Je suis timide mais je me soigne [réalisé par Pierre Richard en 1978, il y campe le rôle d’un grand timide qui sollicite les services d’un spécialiste pour séduire une femme, ndlr]. Ce qui se passe en ce moment avec Paul Mescal ou Timothée Chalamet va plus loin. Dans les années 1970, il y a eu une valorisation du mec gentil et rigolo, qui n’a jamais été dépassée à cause du backlash. Aujourd’hui, ces personnalités masculines ne sont plus des personnages comiques. On est dans une nouvelle ère où des masculinités plus déconstruites sont vues comme séduisantes.

Si vous deviez conseiller trois films de votre corpus à retenir, lesquels seraient-ils ?
La Fiancée du pirate de Nelly Kaplan. C’est un ovni qui a été réalisé en 1969 et elle y fait des choses que même en 1978, à l’apogée du mouvement féministe, personne ne se permet. L’Amour Violé de Yannick Bellon [sorti en 1977, le film suit le parcours d’une infirmière qui se décide à porter plainte après avoir subi plusieurs viols, ndlr]. Il a une dimension didactique mais c’est un film qui demeure très pertinent. La réalisatrice n’en fait pas un rape and revenge [sous-genre cinématographique dans lequel la victime, ou ses proches, se venge d’un viol par la violence, ndlr], son traitement du viol n’est pas spectaculaire, c’est très en avance sur son temps. Et peut-être les premières comédies de Pierre Richard comme Je sais rien mais je dirais tout [sorti en 1973, l’acteur et réalisateur y incarne le fils excentrique du patron d’une usine d’armement, ndlr]. Il va assez loin dans la subversion des normes genrées, notamment avec cette scène de la déclaration d’amour dans laquelle une femme fait l’apologie de son manque de virilité.
Ce que le féminisme fait au cinéma d’Hélène Fiche (Édition Agone)