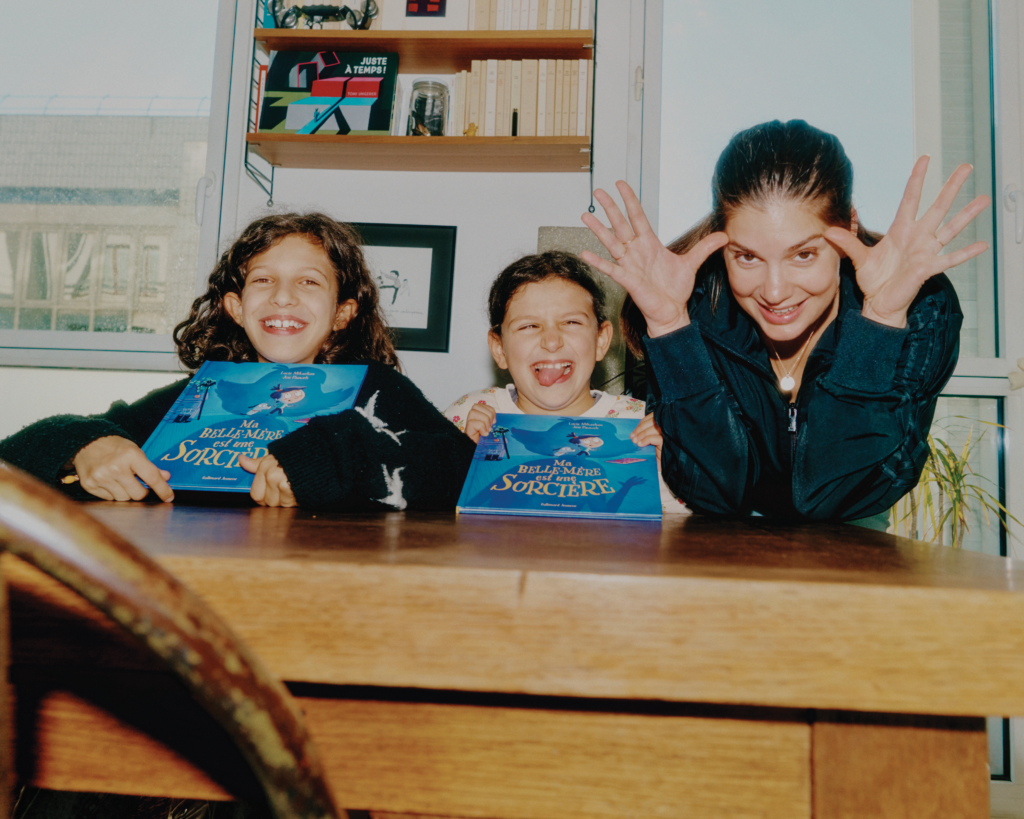Beaucoup de spectateurs ont rapproché Dossier 137 de La Nuit du 12, votre précédent film, qui témoignait déjà de votre intérêt pour le milieu policier et ses dynamiques internes. Qu’est-ce qui vous a donné envie de replonger dans cet univers ?
C’est vrai que dans mes films précédents, même s’il y avait des crimes, la police restait hors champ. La Nuit du 12 [sur un policier de la police judiciaire de Grenoble, qui enquête sur un féminicide, ndlr] a été la première fois où elle était très présente. Ce qui m’a intéressé, c’est le livre de Pauline Guéna [18.3. Une année à la PJ, publié chez Denöel en 2020, ndlr], qui avait passé un an en immersion à la PJ [la police judiciaire, ndlr] de Versailles. Elle y racontait toute la procédure dans le détail, y compris ce qu’on ne montre jamais parce qu’on imagine que c’est ennuyeux : taper des procès-verbaux, gérer la paperasse… C’est justement ce qui m’intéressait, cette lourdeur administrative et ce qu’elle dit du quotidien des enquêteurs. Ça m’a donné envie de poursuivre cette exploration.
Pourquoi avoir choisi de situer votre film au sein de l’IGPN, souvent perçu comme à la fois juge et partie ?
L’IGPN [acronyme qui désigne l’Inspection générale de la police nationale. Surnommé « la police des polices », cet organe de contrôle interne est chargé d’enquêter sur les comportements des policiers, ndlr] m’intriguait depuis longtemps : c’est un service sur lequel on ne sait presque rien, décrié à la fois par les policiers — qui n’aiment pas qu’on enquête sur eux — et par une partie du public, qui estime qu’ils ne font pas leur travail. L’idée d’un personnage d’enquêtrice dans cette position inconfortable, critiquée de toutes parts, me plaisait. J’ai eu la chance de pouvoir faire une immersion d’une semaine à l’IGPN, à la délégation parisienne. Sans cela, je n’aurais pas pu faire le film. J’avais besoin de voir comment les auditions sont menées, d’échanger avec les enquêteurs, de comprendre leurs difficultés, leurs motivations. C’était extrêmement précieux.
Qu’est-ce qui vous a interpellé lors de cette phase d’immersion ?
D’abord, le nombre de femmes. Les horaires y sont plus réguliers que dans d’autres services, ce qui attire plus de policières, souvent encore chargées des tâches familiales. Et surtout, le fait que personne ne va à l’IGPN par vocation : on y arrive par opportunité, souvent pour fuir un autre service. Beaucoup pensent n’y rester qu’un an, car ils y sont très mal vus par leurs collègues. Il y a deux grands types d’enquêtes : celles pour corruption — où ils n’ont aucun état d’âme — et celles liées au maintien de l’ordre, plus complexes. Les enquêteurs se mettent facilement à la place des policiers mis en cause : ils savent dans quelles situations impossibles on les met, avec des armes comme les LBD [lanceurs de balles de défense, une arme de défense réservée aux professionnels de la sécurité, ndlr] ou les grenades de désencerclement. Ils distinguent les policiers vraiment violents, qui ne devraient pas exercer, de ceux qui commettent un geste stupide dans un moment d’exaspération.

Comment rendre cinégénique un univers aussi technique, administratif, procédurier ?
C’était le défi. J’ai trouvé ce langage administratif très particulier intéressant : les PV [procès-verbaux, ndlr], les réquisitions… J’ai voulu le mettre en avant, notamment par la voix off, et travailler sur le rythme. Ce langage devient presque poétique à force de technicité. Beaucoup de gens ont d’ailleurs une vraie curiosité pour ces institutions opaques comme l’IGPN. Ensuite, tout passe par l’écriture et le montage : construire une intrigue policière, avec une tension, des rebondissements, tout en glissant des éléments sur le fonctionnement interne.

C’est la première fois que vous utilisez autant de régimes d’images différents. Comment avez-vous pensé cette hybridation formelle ?
Pendant mon immersion, j’ai constaté à quel point l’image était centrale dans les enquêtes, surtout celles liées au maintien de l’ordre. Les enquêteurs récupèrent des vidéos partout : des caméras de surveillance, des distributeurs bancaires, des smartphones, des journalistes… Ils passent beaucoup de temps à les visionner et à les interpréter. Et une image n’est pas forcément objective : elle peut être floue, cadrée de loin, sujette à interprétation. Avec Gilles Marchand [coscénariste du film, ndlr], on s’est dit que cette profusion d’images devait faire partie intégrante du film. Ces vidéos — surveillance, téléphone, réseaux sociaux — sont les pièces de l’enquête. Et même si, isolées, elles ne font pas cinéma, elles prennent une puissance réelle quand elles sont vues à travers le regard des enquêteurs.
Le film montre aussi comment, pendant la crise des « Gilets jaunes », un vocabulaire très guerrier a été utilisé. Comment comprenez-vous cela ?
Les premiers à employer ce vocabulaire, ce sont les politiques. « Il faut sauver la République », « c’est l’insurrection »… Ces mots sont repris par la hiérarchie policière, puis par les policiers. Si on leur dit que la République est en danger, ils vont agir en conséquence. Cela alimente une logique d’affrontement plutôt que d’apaisement. Il y a évidemment eu des violences chez certains manifestants, mais pour moi, le problème est d’abord politique. Le pouvoir est presque devenu otage des syndicats policiers les plus droitiers, par peur d’être lâché. Cela conduit à toujours plus d’armement, à la présomption de légitime défense, et à une fracture croissante entre police et citoyens. Ce que je déplore, c’est qu’aucun responsable politique n’ait reconnu la souffrance des manifestants blessés. Il suffirait de dire : « Oui, c’est arrivé, cela n’aurait pas dû arriver. » Cette absence de reconnaissance est terrible. Les « Gilets jaunes » se sentaient déjà invisibles, et le sont devenus doublement lorsqu’ils ont été blessés. J’espère, peut-être naïvement, que le film pourra faire bouger un peu les lignes et susciter cette reconnaissance.
Et vous, quel regard portiez-vous sur ce mouvement à l’époque ?
Je dois avouer que je l’ai d’abord regardé de loin, avec méfiance, influencé par le discours médiatique. On parlait d’un mouvement populiste, violent, d’extrême droite. Et puis, peu à peu, j’ai compris que ce n’était pas que ça : il y avait une vraie demande de reconnaissance, une volonté de participer à la démocratie. Ce travail citoyen a été balayé.

Le personnage de Stéphanie est pris entre empathie pour les manifestants et loyauté envers une institution très corporatiste. Comment avez-vous donné corps à ce personnage avec Léa Drucker ?
Le scénario était écrit avant que je propose le rôle à Léa, mais bien sûr, on a adapté certains dialogues en répétitions. Elle a rencontré deux enquêtrices de l’IGPN, avec qui elle a beaucoup échangé. Elle voulait comprendre les aspects techniques, mais aussi émotionnels : comment gérer l’agacement face à un policier de mauvaise foi, ou l’émotion quand une mère vient porter plainte pour son fils blessé. Les enquêtrices disaient : « Il ne faut rien montrer, et surtout ne pas se laisser envahir. » Ce n’est pas qu’elles n’ont pas d’émotions, mais elles les gardent à l’intérieur. C’était la ligne de conduite : que les émotions soient perceptibles sans être exprimées. Léa a fait ça avec une subtilité incroyable.