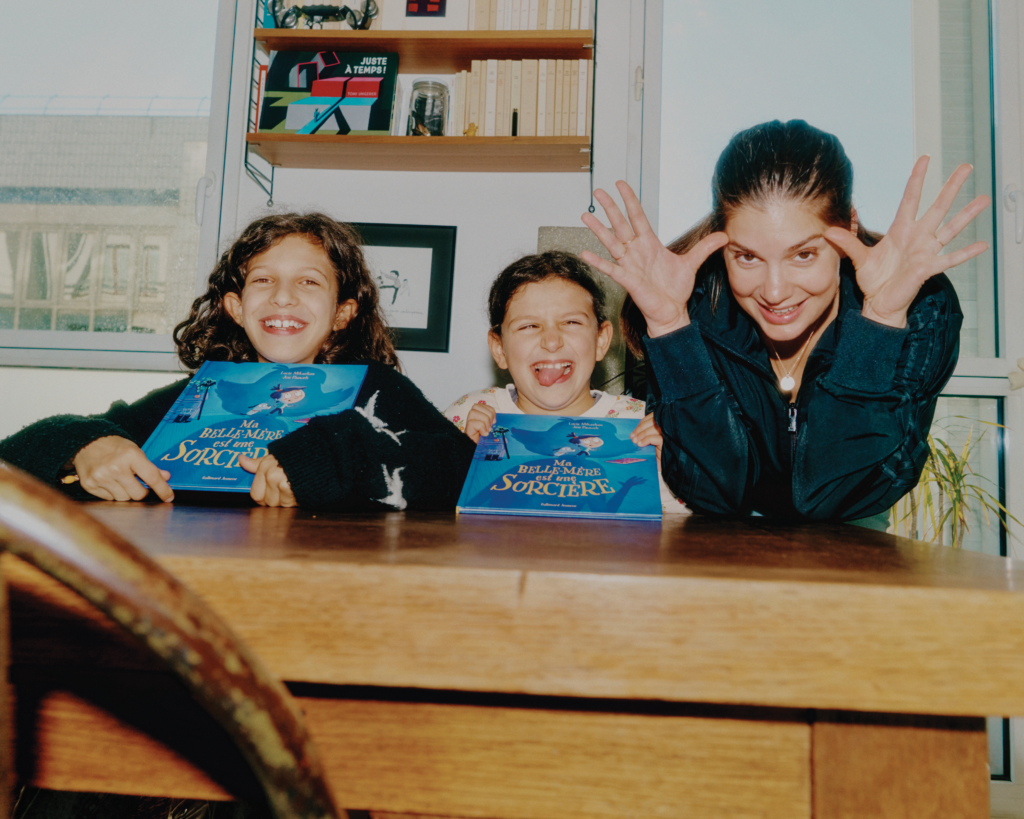Quelques mois après la naissance du mouvement des Gilets jaunes, Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN (soit la police des polices), se voit confier le dossier 137, qui expose le cas de Guillaume, manifestant venu prendre part aux rassemblements parisiens et victime d’un violent impact à la tête suite à un tir de LBD. Stéphanie (Léa Drucker, décidément remarquable) et son équipe se lancent dans un minutieux travail pour retracer le parcours du jeune homme et identifier les policiers l’ayant grièvement blessé. Il est beaucoup affaire d’écrans et de regards dans Dossier 137, de la façon dont les images nous arrivent et dont on choisit de les décrypter.
C’est dans la sphère intime que jaillit d’abord ce trouble, lors d’une scène où Stéphanie discute en FaceTime avec son fils et où il lui montre, amusé, la bagarre qui prend place sous ses yeux, alors qu’il est seul sur un parking. Se raconte l’espace de 10 secondes la banalisation d’une violence intégrée comme quotidienne et l’importance du cadre, Stéphanie décelant dans cette vidéo une menace manifeste, qu’importe le hors-champ. Et le film d’élargir ce banal exemple issu de la vie privée à la polarisation des regards sur les violences policières, au gré de confrontations sidérantes avec les agents que reçoit Stéphanie à son bureau.
Généreux en propositions formelles, Dossier 137 glisse volontiers d’un plan où un personnage regarde son téléphone vers le contenu visionné, en plein écran, pour prévenir l’esquive. L’obsession qu’entretient Stéphanie pour la vérité implacable de l’image, parfois au mépris des procédures, ne manque pas de rappeler l’entêtement de l’infirmière campée par cette même Léa Drucker dans L’intérêt d’Adam de Laura Wandel (Semaine de la Critique). En un miroir tendu à La Nuit du 12, le film n’oublie jamais de faire exister la victime, avec l’humanité qui irrigue inlassablement le cinéma de Dominik Moll.
Dossier 137 de Dominik Moll, Haut et Court (1 h 55), sortie le 19 novembre