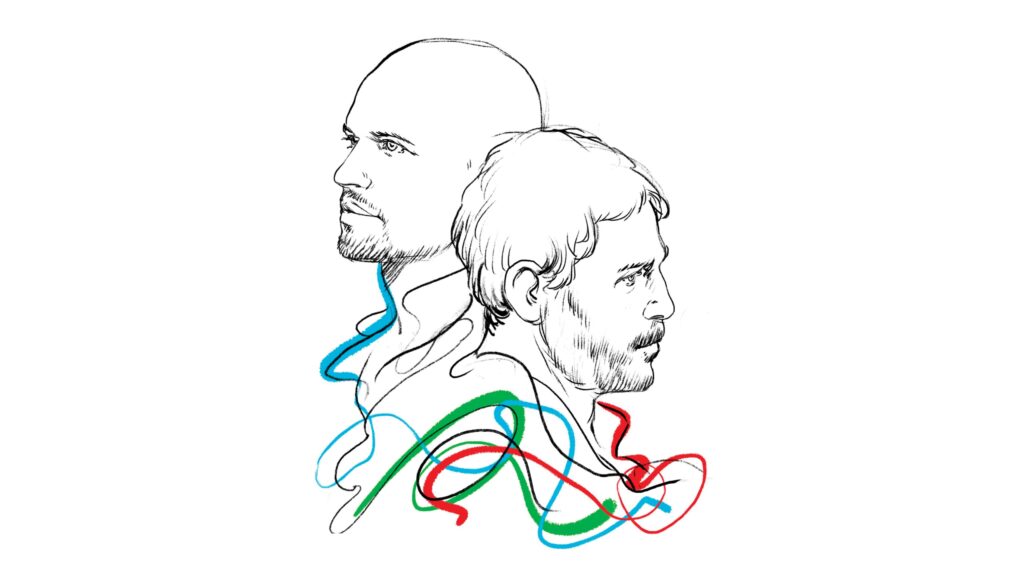
C’est la première fois que vous vous rencontrez ? Que pensez-vous chacun du travail de l’autre ?
Ohad Naharin : On a discuté une fois, c’est tout. Mais il y a des gens avec lesquels on n’a pas besoin de parler pour ressentir une forme d’intimité.
Nadav Lapid : Ma compagne [Naama Preis, ndlr], qui joue dans mon film, était danseuse. Donc je connais ton travail depuis des années, je suis un grand fan. Mais Dieu n’a pas besoin de compliment.
O. N. : N’importe quoi. Ce sont des gens comme toi dont je veux un retour ! Pas forcément des compliments, mais sur ce qu’on partage.
N. L. : Ce que j’aime, c’est ton obsession à mettre des choses contradictoires en dialogue. Parfois, ça crée quelque chose de schizophrénique. Et c’est vrai partout dans le monde, mais, quand on grandit en Israël, la distinction entre le personnel et le collectif est totalement artificielle. Beaucoup de choses – comme aller à l’armée – sont les deux à la fois. Je ressens que tu connectes ces deux choses dans ton travail.
O. N. : C’est une très belle façon de résumer une immense partie de mon travail. J’ai grandi dans un kibboutz [communauté agricole collective israélienne, fondée sur l’entraide, ndlr]. Je dormais avec neuf autres enfants et je voyais mes parents trois heures par jour, donc c’était à la fois très collectif et très personnel. Ma découverte du travail de Nadav est assez récente. Jusqu’à maintenant, j’ai vu deux films : Le Genou d’Ahed [sur un réalisateur israélien qui fait le deuil de sa mère et de la foi en son pays lors d’une projection en plein désert, ndlr] et Oui [sur un musicien israélien qui tente de survivre dans une société traumatisée après l’attaque du Hamas, avant d’être chargé de composer un nouvel hymne national, ndlr]. Quand j’ai vu Le Genou d’Ahed, j’ai été submergé.
Il y a beaucoup de similarités entre vos deux langages, très fragmentaires, peu narratifs…
N. L. : Pour moi, tout repose sur le rythme. Avec mes acteurs, c’est très rare qu’on explique la scène, ses motivations. Souvent, on ne parle que du rythme. Je leur dis : « Ici, tu vas ta-ta-ta-ta-ta. » Je ne suis pas contre la parole, mais j’aime que la parole soit dans l’action, que les mots soient une matière. Qu’on les confronte au cadre. Dans Le Genou d’Ahed et dans Oui, plus le personnage principal parle, plus la caméra tremble, et il n’y a pas d’explication.
O. N. : C’est pour moi l’une des choses les plus importantes à atteindre : le bon moment, le bon rythme, le bon timing. Ce qu’on voit arrive toujours avant ce qu’on entend. Un film ne s’écoute pas, il se regarde. C’est très similaire dans la chorégraphie. J’utilise texte et musique, et j’essaie de tout connecter pour créer ce que j’appelle « la bonne tension ».
N. L. : Je suis d’accord. Quand j’y pense, je suis très jaloux de l’art abstrait. Au cinéma, j’ai toujours l’impression que le plus gros problème, c’est la caméra, très subjective. Tu la poses, ce qui est devant est montré. Il y a une phrase dans la peinture expressionniste qui dit : « Je ne veux pas peindre la voiture, mais le sentiment qu’elle a laissé en moi quand elle est passée. » Je rêve de cadres où il n’y a pas de forme, juste un ressenti, un mouvement. En ce sens, je suis très jaloux de la danse, où l’abstraction est déjà au cœur de l’œuvre.
Vos mises en scène nous plongent souvent dans un chaos abyssal. Quel rapport avez-vous avec cette notion ?
N. L. : C’est important de perdre le contrôle. Sinon, il n’y a pas de liberté. Et je dis ça alors que je suis totalement maniaque du contrôle. Mais, par exemple, c’est pour ça que je mets parfois des animaux dans mes films. On ne dirige pas une fourmi ou un chat. Et justement, la liberté, c’est aussi amener le chaos.
O. N. : Je ne suis pas d’accord. Je dis toujours à mes danseurs de ne jamais perdre le contrôle, non par maniaquerie, mais perdre le contrôle, c’est perdre sa liberté. En danse, surtout, tu peux te blesser ou blesser les autres. Pour moi, l’excès, c’est fondamental, mais toujours avec contrôle.
N. L. : Je crois que je suis attiré par la sensation de danger. Je fais toujours le même rêve quand je tourne : ma voiture fonce vers un mur et, miraculeusement, le mur recule. Il y a une scène de fête au début de Oui. Je ne savais pas quoi en faire, alors qu’elle était cruciale. Ce qui m’a sauvé, c’est d’imaginer Y. tombant dans la piscine, enseveli sous des boules rouges. D’une certaine façon, le clown est mort. Là, je tenais un truc.
O. N. : J’ai eu l’impression, au fur et à mesure que le film tombait en morceaux, qu’il grandissait en moi. Plus le temps passait, plus j’étais dedans.
N. L. : Je ressens que dans mes films, et aussi dans ton travail, le chaos est toujours là. Potentiellement, presque à chaque instant, ça peut devenir incontrôlable.
O. N. : Je demande souvent à mes danseurs ce qu’ils comprennent du chaos. Parfois, les gens disent que c’est du désordre, du bordel. Mais, pour moi, le chaos est beau. C’est quelque chose que tu ne peux pas décrire, mais qui peut être très net. Prends par exemple une tempête : elle est chaotique mais claire, elle a une composition. C’est ça, le chaos.
Nadav, pourquoi avoir dépersonnalisé le protagoniste de Oui en l’appelantY., comme dans Le Genou d’Ahed ?
N. L. : Je déteste les character-driven movies [une fiction plus centrée sur un personnage et ses évolutions que sur le récit, ndlr]. Je me souviens qu’après avoir gagné l’Ours d’or [pour Synonymes en 2019, ndlr], j’ai reçu plein d’appels de producteurs américains qui me demandaient de faire ça. Cette notion me dégoûte parce que, tout à coup, les gens se projettent dans des personnages comme s’ils étaient réels. Quand je regarde un film, je ne m’identifie pas aux personnages, mais à l’esprit du film. J’aime l’idée que cet esprit dépasse le film. Pour ce film, j’ai joué à inventer un personnage sans vrai nom, parce que ce n’est pas vraiment un personnage.
O. N. : Je ressens vraiment tes personnages. Je tiens à eux, je tombe amoureux d’eux. Peut-être que c’est un dispositif que tu utilises pour t’en distancier, dont tu as besoin. Chez moi, il y a quand même une séparation. Je peux apprécier la réalisation du film et, en même temps, aimer l’acteur, ce qu’il me fait ressentir. Un peu comme en danse : le seul moment où mon travail me touche vraiment, c’est quand les danseurs créent une narration que je n’ai pas écrite. Quelque chose dans leur interprétation me touche – eux, non ma chorégraphie.
N. L. : Je comprends. Et heureusement… Je pense que la pire chose qui puisse arriver à un réalisateur, c’est de ne voir dans son film qu’un miroir de lui-même. On veut que les acteurs apportent des contradictions.
Ohad, comment avez-vous perçu dans le film de Nadav Lapid les danses grotesques, les gestes marionnettiques, qui symbolisent la folie qui s’empare de la société israélienne ?
O. N. : J’ai beaucoup apprécié. Mais, ce que j’adore dans le film, c’est l’utilisation du son, indissociable du mouvement. Tu y as investi beaucoup, non ?
N. L. : Oui. Il y a une citation de Jean-Luc Godard que j’ai toujours adorée. Il dit que, dans « audiovisuel », le son vient toujours avant l’image. Pour moi, c’est exactement ça. Quand le son arrive après le tournage, il transforme parfois complètement l’image, il peut même se rire d’elle.
La musique est très présente dans vos œuvres, mais jamais facile, agréable ou illustrative. Comment la choisissez-vous ?
O. N. : La musique provoque des émotions fortes, mais surtout elle marque le temps. J’utilise souvent une musique qui manque de quelque chose pour que la danse la complète.
N. L. : Moi non plus, je ne choisis jamais une musique que j’admire, sinon le film devient un hommage. Avant chaque scène, j’ai un rituel : j’écoute les mêmes musiques – Jean-Sébastien Bach, Pink Floyd… –, que je considère comme des chefs-d’œuvre. Jamais de mélodie sympa. La musique doit rester quelque chose de… en français, on dit « profane ». Dans Oui, par exemple, il y a un moment sur la plage où Y. écoute du Bach. Il teste les paroles d’un hymne génocidaire sur la musique pour voir si ça l’inspire.

Derrière son côté farcesque, le film Oui est une charge violente contre la politique du gouvernement de Benyamin Nétanyahou. Il prend aussi le pouls d’une société israélienne à la fois traumatisée par la tragédie du 7-Octobre et pour partie désensibilisée face aux massacres en cours à Gaza. Comment vivez-vous cette situation apocalyptique, l’un et l’autre ?
O. N. : Je suis très triste et en colère par rapport à tout ce qui se passe. Mais le 7-Octobre, aussi tragique qu’il ait été, ne m’a pas du tout surpris. C’est un cercle de violence, un schéma qui se répète. Dans mon travail, je suis impacté par des annulations [depuis le début de la guerre, le chorégraphe a annulé plusieurs tournées, soit en raison d’une crainte pour la sécurité de ses danseurs, soit en raison de la fermeture de l’aéroport de Tel-Aviv, ndlr], je voyage moins à l’étranger. Mais je ne suis pas une victime. Je vais au studio, je reste en contact avec mon public et mes danseurs…
N. L. : Dès mon premier film d’étudiant, j’étais obsédé par l’idée que ce pays a développé à l’intérieur de lui une sorte de maladie collective. Et je me suis toujours senti en désaccord avec une partie du cinéma politique israélien, qui ne va pas au fond des choses. Je suis d’accord avec Ohad : ce qui se passe, c’est pire que le pire des cauchemars, mais c’était aussi la chose la plus prévisible qui soit. Et bien sûr, nous ne sommes pas des victimes, mais je pense que la position d’artiste israélien n’est pas facile. Il y a une contradiction entre faire partie d’une nation qui fait le pire et vouloir créer quelque chose de bien.
Dans Oui, Y. accepte automatiquement toutes les compromissions, qu’elles soient imposées par la haute société ou par des agents du pouvoir en place. Est-ce que les artistes israéliens peuvent librement dire « non » ?
O. N. : Totalement. En interview, je peux dire des choses horribles sur cette maison de fous qu’est notre gouvernement : corrompu, ignorant, intimidateur. Malheureusement, ça concerne aussi une grande partie du peuple. Donc ce n’est pas juste un problème de gouvernement. Et je n’ai pas peur de le dire. Mais je sens aussi que le dire n’arrangera rien.
N. L. : Si je devais faire une comparaison sur la liberté d’expression, c’est un peu mieux de vivre en Israël qu’en Iran. Mais, ce qui se passe en Israël, c’est la volonté de la nation. Pas de tout le monde, mais d’une grande majorité. Je veux dire que c’est la conséquence de ce que les gens croient être bon. C’est aussi l’une des raisons principales pour lesquelles je suis parti. Parce que j’ai senti que je commençais à haïr les gens, à devenir un monstre parce que je voyais des monstres partout.
O. N. : Je choisis de rester, car il y a des gens capables de construire plutôt que de tout détruire. J’y crois, et je ne suis pas le seul.
Que retenez-vous de cet échange ?
O. N. : Ce que Nadav a dit sur le personnel et le collectif m’a été utile. Et le danger qui s’exprime dans les films, la réalisation, c’est inspirant.
N. L. : J’ai été ému quand Ohad a été ému par mes personnages. Entendre ça me donne une légitimité.
